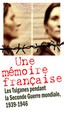| Une mémoire
française Les Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1946 |
Par Christophe Delclitte
Revue Hommes et Migrations, n°1188-1189, juin-juillet 1995
La loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades est un élément essentiel de compréhension de la continuité des traitements législatifs, administratifs et policiers des Tsiganes en France au cours de ce siècle. En vigueur jusqu'en 1969, elle a régi la vie des nomades et les a relégués dans une position de citoyens de seconde zone tenus de faire viser, à chacun de leurs déplacements, des papiers spécifiques portant leur signalement anthropométrique. Abrogée en 1969, elle fut remplacée par une loi, toujours en vigueur, qui ne constitue qu'un assouplissement des dispositions antérieures.
Collection F. Reille, 1912La législation élaborée au début du siècle fut aussi le cadre juridique de l'internement des Tsiganes en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le décret-loi du 6 avril 1940 interdit "la circulation des nomades sur la totalité du territoire métropolitain", au titre que leurs incessants déplacements peuvent constituer pour la défense nationale un danger très sérieux.
Sont assignés à résidence, puis internés les "individus errants, généralement sans domicile, ni patrie, ni profession effective (...) qu'il ne faut pas confondre avec les forains...", en d'autres termes les nomades, c'est-à-dire, édicte le décret-loi, "toutes les personnes réputées telles dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi de 1912".
Ainsi, les catégories sans cesse mobilisées de la fin de la Troisième République à la veille de la Quatrième sont celles de la loi de 1912. Au-delà des éléments de conjoncture, l'historicité de catégorisations et de pratiques, la préexistence d'un système d'ordre, expliquent que le relais s'opère sans solution de continuité entre la république finissante et le régime de Vichy, et que le sort inique fait aux Tsiganes perdure un temps après la Libération, dans l'indifférence générale. [Lire l'intégralité de l'article]
Le projet est parrainé par le cinéaste Tony Gatlif
Il est encadré par un comité scientifique composé d’historiens : Henriette Asséo, Emmanuel Filhol, Marie Christine Hubert, Alain Reyniers, Jacques Sigot
Il est porté par un comité d’organisation composé des associations suivantes : ANGVC (Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques) / ASNIT (Association Sociale Nationale Internationale Tzigane) / FNASAT-Gens du voyage (Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage) / LDH (Ligue des Droits de l'Homme) / MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples) / Romani Art / UFAT (Union Française des Associations Tsiganes) - Nous contacter