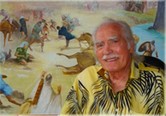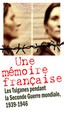| Une mémoire
française Les Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1946 |
"Nous vivions à Gien où nous nous étions fixés depuis une
trentaine d'années. Nous logions dans quatre caravanes.
Un après-midi, des gendarmes sont venus nous dire que nous
devions nous rendre à Orléans, le lendemain, pour un simple recensement. Le pépé, en colère, nous a répété, le soir, qu'il ne partirait jamais si nous étions encadrés par des gendarmes.
Le lendemain matin, après avoir rassemblé nos affaires,
nous avons pris la route. Nous avons commencé à être inquiets quand nous avons vu des gendarmes aux croisements,
ce qui nous interdisait de prendre une autre direction que celle d'Orléans.
A Tigy, on nous a demandé de laisser les caravanes et les
chevaux dans un pré, et l'on nous a fait monter dans des camions
à bestiaux. Nous nous sommes retrouvés dans le camp de
Jargeau. C'était en 1941, et j'avais 9 ans. Nous y sommes
restés dix-huit mois. Quand nous sommes retournés à Tigy pour retrouver nos caravanes, tout était saccagé, inutilisable."
(Témoignage d'Augustine Gaippe, de Jargeau, recueilli
par J.Sigot, Etudes Tsiganes, vol 6, n°2/ 1995 p 68)"Nous nous trouvions du côté de Quimper, dans le Finistère, où nous nous étions à demi sédentarisés dès que nous avions appris les premières arrestations. Nous avions loué une maison que nous occupions à sept : ma grand-mère, mon père et ma mère, mon frère et les deux soeurs. Mes parents étaient journaliers. J'avais alors une douzaine d'années. Un matin, de bonne heure, des gendarmes ont fait irruption chez nous et nous nous sommes aperçus presque aussitôt que plusieurs autres encerclaient la maison. Ils étaient arrivés en fourgonnette. On nous a demandé de rassembler des affaires personnelles et on nous a laissé un peu de temps pour que nous puissions préparer notre départ. Les gendarmes, méfiants, nous suivaient dans chaque pièce. La mamie avait réussi à se cacher dès l'alerte, et personne ne songea à la chercher ; ce qui prouve qu'ils n'avaient pas de liste et qu'ils devaient se contenter d'appréhender tous ceux qu'ils trouvaient. Nous avons vu aussi que les dénonciations, anonymes ou non, sont à l'origine d'arrestations. Que les nomades gênent, cela suffit donc souvent, et souvent exclusivement, à justifier leur internement." (Témoignage de Jean Richard, recueilli par Jacques Sigot, Etudes Tsiganes vol 6, n°2/1995 p 74)
Témoignages audio
Bimbam
récit de Bimbam, dont la famille, frontalière, à l’approche de la guerre passe d’Allemagne en Belgique, puis en France, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui durant l’Occupation est rattaché au commandement allemand de Bruxelles
http://remue.net/spip.php?rubrique548
André Ney
témoignage sonore recueilli par Xavier Bazot
récit d’André Ney dont la famille tsigane fut déportée en Pologne durant la Seconde Guerre mondiale. http://remue.net/spip.php?rubrique438
René Debarre, dit Bébé
témoignage sonore recueilli par Xavier Bazot
René Debarre a un an lorsque sa famille est assignée à résidence à Morlaix, puis internée près de Rennes (s’agissait-il du camp de Plénée-Jugon ?), puis au camp de la Pierre, à Coudrecieux (Sarthe), enfin au camp de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire). René Debarre nous raconte aussi la vie au quotidien d’une famille manouche, quand elle jouit de sa liberté. ttp://remue.net/spip.php?rubrique480
Marie " Tchaia " Hubert
témoignage sonore recueilli par Xavier Bazot
La famille de Marie Hubert a été internée à Rivesaltes, Thonon-les-Bains, Argelès, d'où elle a réussi à s'évader, retraversant la France à pied pour regagner sa région d'origine.
http://remue.net/spip.php?rubrique436
Récit de Raymond Gurême, témoignage sonore recueilli par Xavier Bazot et François Lacroix en 4 parties :
La vie brisée / Le camp de Linas-Montlhéry / Un adolescent dans la guerre / La famille retrouvé
Nicki Lorier
Nicki Lorier évoque la famille de Bimbam, très proche de la sienne. Aujourd’hui il vit à Forbach, où il peint et dessine, notamment à la sanguine.
http://remue.net/spip.php?rubrique560
"Renouer les liens" un travail de mémoire et de réparation Plénée Jugon, 12 novembre 2010
Témoignage de Monique Mouvaux recueilli par l'association " les bistrots de vie du pays briochin " lors de la soirée qui s'est tenue à Plénée Jugon le 12 septmebre 2010, avec l'association Itinérance 22. [Ecouter le témoignage]Le 5 mai 2011, Yves Calvi recevait Raymond Gurême, dans son émission, sur RTL. A 85 ans, l'un des derniers survivants de la tragédie de l’internement des Tsiganes en France publie "Interdit aux nomades", chez Calmann-Lévy, avec Isabelle Ligner. A 15 ans, il se retrouve enfermé dans un camp avec sa famille, mais réussi à s'échapper pour entrer dans la Résistance. Pendant soixante ans, il n'en a pas dit un mot à ses enfants. Après les polémiques sur les Roms de l’été 2010, il décide de sortir du silence. [Ecouter le témoignage]
"Nous étions à Moulins, dans l'Allier, lorsque nous avons été arrêtés la première fois. Ils nous ont alors assignés à résidence en Corrèze. A l'époque, nous avions des roulottes avec des chevaux. Et puis un jour, ils sont venus nous chercher et nous ont mis dans les camps de concentration. On a dû laisser nos roulottes et nos chevaux là-bas et on ne les a jamais récupérés. Ils nous ont pas expliqué pourquoi on allait dans ces camps. Ils nous ont d'abord emmenés à Rivesaltes. Il y avait toute ma famille - les Schaenotz et les Demetrio - qui étaient dans ce camp. Nous sommes restés quelques mois dans celui-ci et puis, avec quelques uns, nous nous sommes échappés. Nous sommes partis à Valence dans l'Ardèche. Ma grand-mère, quant à elle, est restée à Rivesaltes. Elle y décédera peu de temps après. Au bout de trois ou quatre mois, la gendarmerie nous a retrouvés et nous a emmenés au camp de Gurs. Nous sommes restés presque un an dans ce camp. Il y avait beaucoup de juifs. C'était un camp qui était très dur. Après, nous avons été au camp de Noé pendant un mois et nous avons été conduits au camp de Saliers. C'était un camp pour les nomades. Nous étions une quinzaine dans la même maison. Nous dormions les uns sur les autres. Il n 'y avait rien à manger. Heureusement que j'avais un oncle - Yoska Gorgan - qui habitait Maurs et qui nous envoyait des colis de temps en temps. Beaucoup de gens étaient malades. Il y avait plein de moustiques dans ce camp. C'était insupportable. Alors pour faire partir les moustiques on faisait des feux dans les cabanes. Mais à cause de ces feux, on prenait des maladies de peau. Mon père allait travailler dans une ferme à l'extérieur du camp. Mais normalement on n 'avait pas le droit de sortir. Le camp n'était pas très bien gardé et ce n'était pas très difficile de pouvoir s'en échapper. Seulement même si on partait, on était repris à quelques kilomètres. J'ai deux frères qui ont quand même réussi à s'enfuir. Ils sont partis dans le Cantal retrouver mon oncle. Mais là-bas, les Allemands sont venus pour faire une rafle. Mes deux frères ont été déportés en Allemagne. Seul Pierre est revenu vivant. Nous, on est resté au camp de Saliers jusqu'à la fin, quand celui-ci a été bombardé. Nous sommes rentrés à Maurs à pied. Le retour a duré plus d'un mois. On a vu beaucoup de morts sur la route. C'est quand on est arrivé à Maurs qu'on a appris qu'une partie de la famille avait été déportée en Allemagne. On a revu mon frère longtemps après". (Témoignage de Roger Demetrio, recueilli par Mathieu Pernot, Etudes Tsiganes, n° 13, 1999 p.151)
"On a souffert aussi à Jargeau. Par contre, on ne voyait pas les Allemands, le camp était gardé par les Français.
"Je me souviens quand même d'une fois où j'ai vu les Allemands qui sont venus jouer avec nous. Ils avaient enduit un poteau de mélasse, et au sommet ils avaient déposé une pièce de monnaie. Il fallait grimper au poteau et attraper la pièce uniquement avec les dents. C'était trop difficile, ça glissait et ça collait, on y arrivait rarement et on disputait notre tour. Les Allemands eux, ils rigolaient bien ! " On allait aussi à l'école. La nourriture était la même, de la soupe, toujours de la soupe, on n'a jamais mangé un seul morceau de viande. Un jour que nous avions faim et qu'on cherchait avec d'autres gamins une nourriture quelconque, on avait remarqué un gardien qui mangeait une pomme devant nous. Il a jeté le trognon à terre et on s'est jeté dessus. Le lendemain, il est revenu avec une pomme, après l'avoir mangée, il a écrasé le trognon sous son pied. Cela m'a marquée et c'est resté dans ma mémoire.
" L'hiver on avait froid, on avait des lits superposés en bois. Il y avait un poêle par baraque, mais sans bois. On crevait de froid, alors mon père a cassé les lits pour nous faire du feu, mais après on dormait par terre, et comme mon père était nommé chef de baraque, il a dû sûrement y avoir des représailles."
(Témoignage de Mme Félix, née Chandello, recueilli par E Filhol, Etudes Tsiganes n°13, 1999 p.58)"En 1942, je me souviens plus des dates, ni qui en a donné l'ordre, nous avons pris à notre service environ 15 personnes retenues à la Saline Royale. Je me souviens de certains noms : Chandello, Remetter, Winterstein, Reinhart...
Amenés par des gendarmes, ces nomades étaient gardés avec toute leur famille, par des douaniers. Ils étaient " parqués ", c'est le mot, dans des pavillons jouxtant les grands bâtiments. La Saline Royale, propriété, à l'époque, des Beaux-Arts, était abandonnée, les abords des bâtiments étaient en friche.
Les pavillons aux grandes pièces, froides et sales, avaient les carreaux des fenêtres cassés. C'était le domaine des chouettes et des rats. Pas de chauffage. Nous leur avons apporté quelques vieux poêles fumants. En guise de lit, un tapis de paille et quelques couvertures pour toutes les nombreuses familles avec des enfants en bas âge et des à peine plus âgés pourtant " pleins de vie ", malgré la précarité. L'eau à une seule fontaine dans la cour. Pas de toilettes... les buissons des friches proches servant de cabinet d'aisance. Chaque matin, à 6 h l'été et à 7 h 30 l'hiver, sous la surveillance des douaniers, j'allais chercher nos bûcherons dans leurs bâtiments. Un certain douanier refusait de m'accompagner... il avait peur des puces... ou autre vermine. On trouvait pourtant normal de loger ainsi des êtres humains." (Témoignage de Mr Prétot, exploitant forestier en forêt de Chaux, recueilli par E. Filhol, Etudes Tsiganes n°13, 1999 p.63)Sur les conditions matérielles du camp de Moisdon :
Si quelques familles, parmi les mieux, sont réunies dans une pièce avec quelques paillasses pour s'étendre le soir venu, toutes les autres sont parquées comme des bêtes dans deux grands baraquements de bois, repoussants de saleté, où jamais ne pénètrent ni le soleil, ni l'air. Dans cet immense taudis aussi sombre à midi que le soir, vivent des êtres humains. Deux ou trois caisses contenant chacune une paillasse et quelques lambeaux de couverture, sont superposées les unes au-dessus des autres pour abriter une famille entière.
Les cheveux en broussailles, la figure et les mains noires, les pieds nus sur le sol boueux, le corps recouvert de quelques haillons, de pauvres enfants, innocentes victimes, s'étiolent dans cette atmosphère de vice et de saleté.
Autour du poêle allumé, se pressent les plus vieux, les malades, les plus petits. Une jeune femme tuberculeuse, de retour de sana, entourée de ses petits, réchauffe ses membres douloureux et nus, et sème la contagion. Cette description du camp ne traduit pas la compassion qu'en ressent le visiteur. Une première solution s'impose d'urgence : envoyer vêtements et linge.
(rapport de l'assistante sociale principale, Nantes, le 8 novembre 1941, cité par J. Sigot, Etudes Tsiganes vol6, n°2/1995 p 156)Monseigneur,
Dans un cas absolument exceptionnel, j'ai recours à votre bon coeur en faveur d'environ 300 malheureux nomades français qui viennent d'arriver sur ma paroisse, dans le camp de Méron-Montreuil, et qui se trouvent dans un état absolument lamentable. Parmi eux, il y a plus de soixante enfants qui grelottent dans leurs haillons, plusieurs sont pieds nus ; dix-huit femmes, m'assure-t-on, sont enceintes. Or, rien n'était, et n'est encore prêt pour les recevoir : ni literie, ni linge, ni bois de chauffage, ni cabinets. La nourriture est très déficiente, et pourtant, les légumes ne manquent pas dans le pays. Ils couchent sur la paille, sans couverture.(Lettre adressée à son évêque le 21 novembre 1941 par François Jollec, curé de Méron, citée par J. Sigot, Etudes Tsiganes, vol 6, n°2/1995 p 32)"Le dimanche, j'prenais ma fille sur le porte-bagages de mon vélo et on allait jusqu'au camp. Ils étaient ni plus ni moins qu'des bêtes derrière leur grillage. On leur lançait du pain ; c'est qu'ils avaient faim." (Témoignage de Marinette Maria rapportant des paroles d'une Montreuillaise qui préfère garder l'anonymat, cité par J. Sigot, Etudes Tsiganes, vol 6, n°2/ 1995 p 170)
"Les Allemands nous ont pris à Meysse dans l'Ardèche. Les gendarmes sont venus nous chercher dans notre maison. Ils nous ont dit qu'ils nous mèneraient dans un pays où nous aurions des maisons et dans lequel nous serions bien nourris. Alors, nous sommes allés au camp de Barcarès, puis à celui de Rivesaltes. Nous sommes presque restés six mois dans ce camp. Nous étions mélangés avec d'autres personnes qui n'étaient pas gitanes. Et puis un jour, ils ont pris des hommes de chez nous pour les emmener à Saliers pour qu 'ils y construisent les maisons. Parmi eux, se trouvaient mon père et mes deux frères. Au bout d'un certain temps, comme on ne les avait pas vus depuis longtemps et qu'on se faisait du souci pour eux, je me suis échappée du camp de Rivesaltes avec ma mère pour aller les voir. Nous avons pris le train jusqu 'à Nîmes et sommes allées à Saliers. Nous sommes restées une nuit dans ce camp avec mon père et lorsque le chef du camp nous a trouvées le matin, il nous a obligées à repartir à Rivesaltes.
"Et puis, quelques mois après, lorsque le camp de Saliers était construit, on est venu nous chercher et avec des camions on nous a emmenés à la gare. Monsieur Pelet, le directeur du camp, nous a accueillis et nous avons pu retrouver notre papa et nos deux frères. Chaque famille était regroupée dans les petites maisons en chaume. Nous étions treize de la famille dans la baraque 25. Par la suite mes frères ont été mis au travail obligatoire au camp d'Istres. Mon père, ma pauvre sœur et ma tante travaillaient en cuisine, avec Monsieur Sevolli qui était le cuisinier et qui venait de Saint-Gilles. Moi, je devais faire le service pour les gardiens, les infirmières et le commandant du camp. Cela faisait plus de trois tables à faire pour chaque repas. Nous étions des misérables dans ce camp. On mangeait des épinards pleins de terre et une fois, on a même trouvé un rat dedans. Je me souviens qu 'un jour nous sommes allés dans un restaurant à Saint-Gilles où les Allemands allaient habituellement manger, pour y récupérer des épluchures de pommes de terre. Mais quand ils nous ont vus, ils ont fait exprès de marcher sur ces épluchures pour que nous ne puissions pas en manger. Nous étions traités comme des chiens là-dedans. Ma petite sœur Antoinette est morte dans le camp, elle avait neuf ans. Un de mes frères est également mort peu de temps après les camps tellement il y avait été mal traité. (…) "
(Témoignage de Germaine Campos recueilli par Mathieu Pernot, Etudes Tsiganes, n°13, 1999, p.153)
Le projet est parrainé par le cinéaste Tony Gatlif
Il est encadré par un comité scientifique composé d’historiens : Henriette Asséo, Emmanuel Filhol, Marie Christine Hubert, Alain Reyniers, Jacques Sigot
Il est porté par un comité d’organisation composé des associations suivantes : ANGVC (Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques) / ASNIT (Association Sociale Nationale Internationale Tzigane) / FNASAT-Gens du voyage (Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage) / LDH (Ligue des Droits de l'Homme) / MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples) / Romani Art / UFAT (Union Française des Associations Tsiganes) - Nous contacter